Conditions de production d’une preuve illicite ou déloyale : une jurisprudence réaffirmée

19 mai 2025
Dans un arrêt d’Assemblée plénière en date du 22 décembre 2023 (1), la Cour de cassation a aligné le traitement de la preuve illicite et déloyale dans le procès civil avec les règles régissant le procès pénal. Une preuve obtenue de manière déloyale n’est plus écartée automatiquement des débats ; le juge devant apprécier si une telle preuve porte une atteinte proportionnée au but poursuivi et est indispensable à son exercice, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits concurrents en présence.
Depuis cet arrêt, la Cour de cassation continue de réaffirmer sa jurisprudence.
Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a considéré que la production de fichiers présents sur des clés USB personnelles branchées sur l’ordinateur professionnel du salarié, bien que portant atteinte à la vie privée de ce dernier, est recevable dès lors qu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte demeure proportionnée (2) (Cass. soc., 25 septembre 2024, n°23-13.992).
Récemment, par deux arrêts en date du 26 février 2025, la Cour de cassation admet la production d’éléments de preuve obtenus de manière illicite et déloyale dès lors qu’ils sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnés au but poursuivi, à savoir la protection des intérêts légitimes de l’employeur, et la confidentialité de ses affaires (Cass. soc., 26 février 2025, n°22-18.179 ; Cass. soc., 26 février 2025, n°22-24.474).
Les circonstances des affaires du 26 février 2025
Dans la première affaire soumise à la Cour de cassation (Cass. soc., 26 février 2025, n°22-18.179), un salarié – directeur de site au sein d’une concession automobile – avait, alors qu’il était en préavis de démission, été congédié pour faute lourde (requalifiée en faute grave par les juges du fond) pour avoir engagé la création d’une société avec laquelle il comptait racheter une concession concurrente, alors qu’il était soumis à une clause de discrétion et de non-concurrence.
Précisément, le salarié avait divulgué, au moyen de sa boite mail personnelle, des informations confidentielles appartenant à l’entreprise. Contestant la rupture de son préavis, le salarié soutenait que les preuves apportées par l’employeur étaient illicites, car reposant sur des échanges de courriels issus de sa boîte mail personnelle.
Dans la seconde affaire (Cass. soc., 26 février 2025, n°22-24.474), un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir divulgué des informations particulièrement confidentielles à une entreprise tierce afin d’organiser la reprise de la société.
Pour justifier le licenciement, l’employeur produisait la retranscription d’enregistrements vidéo réalisés dans les locaux de l’entreprise, à l’insu du salarié. Le salarié contestait son licenciement en invoquant une atteinte à sa vie privée.
Dans ces deux affaires, les juges du fonds considèrent que les éléments de preuve en présence sont recevables car indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi, à savoir la défense des intérêts légitimes de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
Les salariés ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée était celle de la recevabilité du mode de preuve apporté par l’employeur.
Sur la recevabilité des échanges de courriels provenant d’une messagerie personnelle
Dans la première affaire (n°22-18.179), le salarié soutenait que la recevabilité des échanges de courriels provenant de sa messagerie personnelle était contraire à l’article 9 du Code de procédure civile, à l’article 9 du Code civil, ainsi qu’à l’article L.1121-1 du Code du travail.
La Cour de cassation, à l’instar de la Cour d’appel, ne lui donne pas gain de cause.
La chambre sociale soutient que la production en justice par l’employeur de courriels, dont il n’était pas contesté qu’ils provenaient de la messagerie personnelle du salarié, constituait effectivement une atteinte à la vie privée du salarié.
Pour autant, une preuve obtenue de manière illicite n’a pas à être écartée automatiquement des débats au seul motif que la production d’un élément probatoire porte atteinte à sa vie privée.
La Cour de cassation confirme donc le contrôle opéré par les juges du fond qui ont constaté que l’employeur s’était « borné » à produire les messages échangés par le salarié, démontrant qu’il était effectivement en pourparlers en vue de la création d’une société concurrente et qu’il transmettait des informations confidentielles de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes.
L’atteinte est ainsi considérée comme proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des intérêts de l’employeur et la confidentialité de ses affaires.
Sur la recevabilité d’enregistrements vidéo réalisés à l’insu du salarié
Dans la seconde affaire (n°22-24.474), le salarié arguait que la recevabilité des enregistrements vidéo réalisés à son insu constituait un procédé déloyal en violation de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales sur le droit au procès équitable.
Une nouvelle fois, la Cour de cassation censure les moyens invoqués par le salarié et suit le raisonnement adopté par les juges du fond. Elle retient que la production par l’employeur de retranscription d’enregistrements vidéo réalisés dans les locaux de l’entreprise à l’insu du salarié constitue effectivement un mode de preuve déloyal et une atteinte à la vie privée du salarié, à savoir l’exploitation de données personnelles.
Cependant, d’une part, la production de ces éléments était indispensable à l’exercice du droit à la preuve par l’employeur, car ils constituaient les seules pièces dont il disposait pour démontrer la faute du salarié (divulgation de données hautement confidentielles à une entreprise tierce).
D’autre part, l’employeur s’était limité à produire la retranscription des conversations liées à l’activité professionnelle, sans recourir à un stratagème visant à provoquer la commission d’une faute par le salarié.
La production de ces éléments était donc proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
Le secret de la confidentialité des affaires : un intérêt légitime à protéger
Dans ces deux affaires du 26 février 2025, la Cour de cassation considère, à l’issue de la mise en balance des intérêts en cause, que l’intérêt légitime de l’employeur à préserver la confidentialité de ses affaires justifie une atteinte à la vie privée du salarié.
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation met en exergue la protection du secret des affaires de l’employeur.
Déjà, dans un arrêt du 30 septembre 2020 (3), la Haute juridiction avait admis que la préservation de la confidentialité des affaires de l’employeur justifiait la production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié.
En l’espèce, il s’agissait d’une publication sur le réseau social Facebook, issue du compte personnel de la salariée, dévoilant en avant-première la nouvelle collection de vêtements de la société avant son lancement officiel. La Cour de cassation avait alors retenu que la production de la publication litigieuse était admissible dès lors qu’elle était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée à la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi.
Si la protection du secret des affaires a effectivement été consacrée par la loi du 30 juillet 2018 (4), elle n’est pas pour autant garantie par un droit fondamental. On aurait donc pu en déduire qu’en cas de conflit avec le droit au respect de la vie privée, ce dernier l’emporterait systématiquement.
Tel n’est pas le cas. En caractérisant à nouveau la confidentialité des affaires comme un « intérêt légitime de l’employeur », la Cour de cassation confirme que sa défense peut justifier une atteinte à la vie privée d’un salarié, à condition que cette atteinte demeure proportionnée au but poursuivi et que la preuve apportée présente un caractère indispensable.
Cette solution tombe sous le sens : la communication, par un salarié, d’informations hautement confidentielles de nature technique, commerciale, financière…à une entreprise concurrente ou à des tierces personnes entraîne des conséquences préjudiciables pour la société (notamment préjudice financier et réputationnel).
Un modus operandi réaffirmé
Ces deux décisions du 26 février 2025 s’ajoutent à la saga sur la production de modes de preuves illicites ou déloyaux.
L’objectif de la Cour de cassation se devine en filigrane : une partie ne doit pas être privée de tout moyen de faire la preuve de ses droits, et ce, conformément au droit à chacun au procès équitable.
Au travers de ces deux décisions, la Cour de cassation déroule une nouvelle fois son fil rouge :
L’illicéité ou la déloyauté dans le mode de preuve n’est pas exclue dans le procès civil, sous réserve :
-
- que la production des éléments de preuve soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve,
-
- et que l’atteinte portée par la production de cette preuve à d’autres droits soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Toutefois, le curseur est placé haut : pour être produite devant un juge civil, la preuve illicite ou déloyale doit présenter un caractère «indispensable» à l’exercice du droit à la preuve, et non simplement « nécessaire ». Cela suppose donc que la preuve contestée soit le seul moyen, pour celui qui s’en prévaut, de prouver ses prétentions.
Cette condition sous-entend qu’il ne doit pas exister d’alternatives, d’autres moyens de preuve qui seraient moins attentatoires aux droits, susceptibles d’être invoqués dans la procédure. Cela n’avait pas été le cas dans une affaire dans laquelle la Cour de cassation avait refusé la production d’enregistrements extraits de vidéosurveillance démontrant les détournements de fonds commis par une salariée licenciée en présence d’un audit diligenté antérieurement qui avait déjà mis en évidence de nombreuses irrégularités (5).
Mais ce n’est pas tout, le seul fait que la production de cet élément de preuve soit indispensable est insuffisant. Les juges du fonds doivent opérer un contrôle strict et précis de la proportionnalité en mettant en balance le droit à la preuve et les autres droits en présence. Ce contrôle est opéré in concreto, de sorte qu’il est naturellement teinté de subjectivité, exposant ainsi les justiciables à une incertitude juridique.
En effet, on comprend aisément que l’appréciation du caractère proportionné dépend de nombreux facteurs : de la légitimité du but poursuivi, des droits et libertés en présence, ou encore du degré de loyauté du procédé utilisé (un élément simplement obtenu à l’insu de celui auquel on l’oppose et un élément obtenu à la suite de manœuvres ou de stratagèmes faisant état d’une provocation à la commission de la faute, ne seront pas appréciés et contrôlés de la même manière par les juges, et ce peu important la légitimité du but poursuivi de la partie qui l’invoque).
Le paysage jurisprudentiel évolue progressivement et mérite une attention particulière, la Cour de cassation semblant assouplir peu à peu sa jurisprudence concernant la production de modes de preuve illicites ou déloyaux à travers une mise en balance des intérêts en présence et un strict contrôle de proportionnalité, qui tend à s’ériger en un véritable modus operandi à suivre.
Dans un arrêt récent du 19 mars 2025 (6), la Cour de cassation s’est attelée à la même mise en balance des intérêts concurrents pour retenir que le comportement fautif d’un salarié pouvait être établi par la production exclusive de témoignages anonymisés.
Pour mémoire, il ne faisait aucun doute que le juge civil pouvait prendre en considération des témoignages anonymisés, mais à la condition que d’autres éléments versés aux débats viennent les corroborer.
Or, pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation admet qu’un employeur puisse établir la faute d’un salarié en produisant uniquement des témoignages anonymisés à la condition que leur production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il convient néanmoins de noter que, dans cette affaire, le salarié avait eu connaissance des témoignages (recueillis par un huissier de justice), et avait été mis à même de s’expliquer contradictoirement à ce sujet.
AUTEURS
Anaïs Vandekinderen, Avocate Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Carla Torresilla Spinella, Elève-avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
(1) Cass. soc., 22 décembre 2023, n°20-20.648
(2) Cass. soc., 25 septembre 2024, n°23-13.992
(3) Cass, soc., 30 septembre 2020, n°10-12.058
(4) Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
(5) Cass, soc., 8 mars 2023, n°21-17.802
(6) Cass. soc., 19 mars 2025, n°23-19.154
Related Posts
La cour d’appel de Versailles estime que les titres-restaurant relèvent des a... 16 juillet 2025 | Pascaline Neymond

Admission de la preuve déloyale: une option très encadrée pour l’employeur... 19 janvier 2024 | Pascaline Neymond

RGPD et droit de la preuve en matière de discrimination : un équilibre diffici... 13 février 2025 | Pascaline Neymond

Témoignages anonymisés : un juste équilibre entre droit à la preuve et droit... 28 avril 2025 | Pascaline Neymond
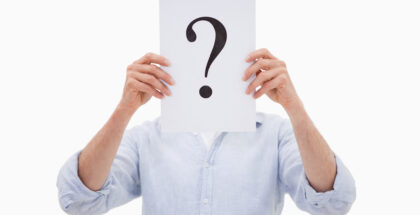
Enquête interne : c’est l’employeur qui décide... 28 janvier 2026 | Pascaline Neymond

Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail... 13 janvier 2026 | Pascaline Neymond

Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : l’illicéité du moyen d... 16 janvier 2023 | Pascaline Neymond

Barème Macron : une résistance modérée des juges du fond non tolérée par l... 18 septembre 2023 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Enquête interne : c’est l’employeur qui décide
- Une nouvelle génération d’action de groupe en droit du travail
- Prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : le juge étend sa solution aux cycles de travail
- Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
- Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
- Création d’un congé supplémentaire de naissance
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance


