Convention collective des journalistes et indépendance éditoriale : cas pratique chez les pompiers

10 août 2017
La convention collective des journalistes est particulièrement favorable à ces derniers, s’agissant notamment du calcul de l’indemnité de licenciement, à raison d’un mois de salaire par année d’ancienneté pour les quinze premières et à l’appréciation exclusive de la commission arbitrale des journalistes pour les années suivantes.
La condition pour en bénéficier est de justifier de la qualité de journaliste professionnel, statut dont la définition figure à l’article L.7111-3 du Code du travail :
« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
La Chambre sociale de la Cour de cassation a déjà précisé que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel pouvait être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale (Cass. soc., 25 septembre 2013, n°12-17.516).
L’arrêt du 29 mars 2017 de la Cour de cassation apporte un nouvel éclairage sur cette notion d’indépendance éditoriale, à propos d’une publication assurée par les Editions des sapeurs-pompiers de France (Cass. soc., 29 mars 2017, n°15-28.228).
La cour d’appel de Paris avait en effet refusé le bénéfice de la convention collective des journalistes au rédacteur en chef de la publication qui ne disposait pas, selon elle, d’une indépendance éditoriale aux motifs que la publication était entièrement détenue par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et que son directeur, qui avait le grade de colonel, intervenait directement dans la rédaction de ses articles de façon brutale et péremptoire.
La Cour de cassation a infirmé cette décision, considérant que la publication bénéficiait bien d’une indépendance éditoriale dès lors que la société disposait d’une autonomie économique et organisationnelle, le colonel ayant pour sa part agi en qualité de directeur de la publication.
Elle semble ainsi opérer une distinction entre l’indépendance éditoriale du journaliste, placé sous un lien de subordination classique, et l’indépendance éditoriale de la publication qui constitue la seule condition d’application de la convention collective des journalistes lorsque l’employeur n’est ni une entreprise, ni une agence de presse.
Auteurs
Rodolphe Olivier, avocat associé en droit social
Laurent Kaspereit, avocat spécialisé en matière de contentieux social devant toute juridiction.
Related Posts
Procédures collectives : les pouvoirs de l’inspecteur du travail limités... 5 juillet 2016 | CMS FL

Le consentement aux traitements d’analyse des correspondances électroniqu... 16 août 2017 | CMS FL

Le harcèlement moral : l’épreuve de la preuve... 10 juin 2013 | CMS FL
Le juge du référé peut-il ordonner la réintégration à son poste d’un... 4 octobre 2021 | Pascaline Neymond
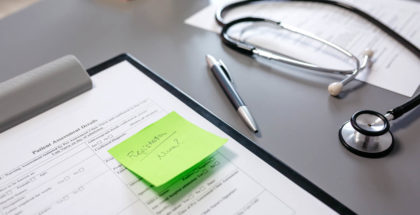
La contestation des décisions du médecin du travail... 21 février 2019 | Pascaline Neymond
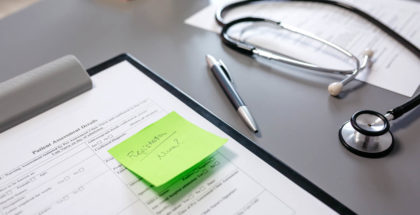
Modalités de vote au sein du comité de groupe : les précisions du Tribunal ju... 30 septembre 2021 | Pascaline Neymond

Quelle solution pour l’employeur si le médecin du travail refuse de se pronon... 20 mars 2019 | CMS FL
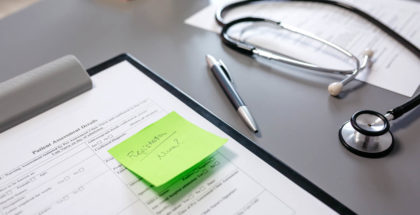
Du caractère abusif ou non de la rupture d’une période d’essai... 22 septembre 2021 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Enquête interne : c’est l’employeur qui décide
- Une nouvelle génération d’action de groupe en droit du travail
- Prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : le juge étend sa solution aux cycles de travail
- Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
- Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
- Création d’un congé supplémentaire de naissance
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance


