Profil LinkedIn et mode de preuve – Le droit à l’épreuve des réseaux sociaux

6 mai 2022
Les informations contenues dans le profil LinkedIn d’un salarié peuvent-elle être utilisées comme éléments de preuve lors d’un contentieux prud’homal ? La Cour de cassation répond de manière implicite par l’affirmative dans son arrêt du 30 mars dernier (Cass. soc. 30 mars 2022, n°20-21.665).
L’acceptation implicite de l’utilisation du profil LinkedIn comme mode de preuve
Les faits soumis à la Cour de cassation dans cette affaire relèvent d’une contestation de licenciement classique.
Une salariée ayant fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle conteste son licenciement devant le juge du travail.
La Cour d’appel de Versailles considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Se pose alors la question de l’étendue du préjudice de la salariée injustement licenciée.
Le licenciement étant intervenu antérieurement à l’entrée en vigueur du « Barème Macron » le 23 septembre 2017, suite à son introduction par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la somme allouée n’est pas encadrée par les planchers et plafonds prévus.
Peu important en l’espèce, puisqu’avant comme après la mise en place de ce barème, le juge prud’homal alloue des dommages et intérêts au salarié en fonction du préjudice subi par ce dernier.
A ce titre, les juges prennent en considération la situation personnelle et professionnelle du salarié et sont amenés à se poser plusieurs questions : Le salarié est-il toujours au chômage ? Combien de temps a-t-il mis pour retrouver un emploi ? …
En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles avait décidé de limiter la somme allouée à la salariée licenciée à 10.000 euros. Pour cela, elle s’appuyait sur un extrait de son profil LinkedIn produit par son ancien employeur de nature à démontrer qu’elle avait retrouvé un emploi un mois seulement après son licenciement.
La salariée s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation décide de casser l’arrêt de la Cour d’appel considérant qu’elle avait dénaturé les termes clairs et précis de l’extrait du profil LinkedIn de la salariée.
En effet, la salariée avait simplement « réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d’une entreprise » et n’avait pas trouvé de nouvel emploi.
Néanmoins, et c’est en cela que l’arrêt est intéressant, la Cour de cassation ne revient pas sur la licéité de la preuve produite par l’employeur.
En d’autres termes, le profil LinkedIn d’un salarié peut tout à fait être utilisé par un employeur comme élément de preuve.
Le procès prud’homal à l’épreuve des réseaux sociaux
Cette solution s’inscrit dans la ligne directe des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de preuve dans le contentieux prud’homal.
C’est notamment sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile suivant lequel « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » que la Cour de cassation exige la loyauté de la preuve, qu’elle applique de manière stricte à l’employeur.
Cette exigence n’est pas pour autant pas sans limite puisqu’elle ne doit pas empêcher l’exercice du droit à la preuve, issu des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (droit à un procès équitable et droit au respect de la vie privée et familiale) et consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 10 oct. 2006, L.L. c/ France, n°7508/02).
Or, dès lors que de nombreux éléments concernant la vie personnelle ou professionnelle d’un salarié peuvent être à portée de main, au moyen d’une simple recherche internet, il peut être tentant pour un employeur d’assurer sa défense en utilisant les données partagées par les salariés sur les réseaux sociaux.
Guidée par le principe de loyauté, la Cour de cassation fait historiquement une distinction entre les informations relevant du domaine public et celles relevant du domaine privé.
L’arrêt du 30 mars 2022 n’indique pas de quelle manière ont été récupérées les informations sur le compte LinkedIn de la salariée ni si les informations étaient accessibles publiquement. L’employeur était-il « connecté » avec la salariée sur LinkedIn ? Un collègue a-t-il partagé les informations à son employeur ?
La distinction entre espace privé et public a récemment fait l’objet d’un infléchissement jurisprudentiel dans le cadre de l’arrêt « Petit Bateau » (Cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-12.058).
Dans cette affaire, une photographie postée par une salariée sur son compte Facebook privé, partagé à l’employeur par un des « amis » de cette salariée, avait permis à l’employeur de justifier le licenciement de cette dernière.
Ainsi, l’atteinte portée à la vie privée du salarié, du fait d’un élément de preuve tiré de son espace privé, peut être justifié à certaines conditions strictes, si :
-
- L’utilisation de cette preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
-
- L’atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi ;
-
- La preuve a été obtenue loyalement.
Dans l’affaire du 30 mars 2022, la possibilité pour l’employeur de produire des informations issues du réseau professionnel tel que LinkedIn semble logique puisque ces informations sont publiées dans le cadre d’un réseau professionnel où, par définition, les contacts d’une personne se limitent rarement à ses seuls amis.
Dans ces conditions, la manière dont l’employeur s’est procuré ces informations importe peu.
En conséquence, les salariés qui partagent des informations sur un réseau professionnel tel que LinkedIn doivent le faire en connaissance de cause.
L’arrivée du métaverse et de la possibilité d’évoluer dans un monde parallèle à celui que l’on connait aujourd’hui promet de nouveaux questionnements juridiques passionnants sur le droit à la preuve.
Related Posts
L’impact de la loi Rebsamen sur le contentieux de la discrimination syndicale... 14 mars 2016 | CMS FL

Covid-19 : nos analyses pour vous accompagner... 30 mars 2020 | CMS FL

Prise d’acte : poursuite du durcissement contre les départs opportunistes... 4 août 2014 | CMS FL
Contrôle URSSAF : conséquences de la nullité de la mise en demeure... 23 janvier 2019 | CMS FL
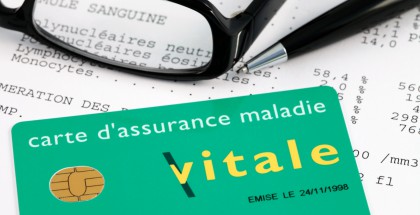
Le harcèlement moral : sa preuve et l’intérêt pour l’employeur de le pré... 6 juillet 2016 | CMS FL

Covid-19 : Nouveaux aménagements des délais de suspension, de report et de pro... 20 mai 2020 | CMS FL Social

Le droit à la preuve : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne ?... 20 avril 2023 | Pascaline Neymond

La cession des titres à l’épreuve des droits de préemption. Contentieux ré... 6 avril 2018 | CMS FL

Articles récents
- Les personnes engagées dans un projet parental sont protégées des discriminations au travail
- Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement est-il toujours nul ?
- Entretien préalable : faut-il informer le salarié de son droit de se taire ?
- Courriels professionnels : un droit d’accès extralarge
- La loi élargit l’action de groupe à tous les domaines en droit du travail
- Exploitation du fichier de journalisation informatique à des fins probatoires : les conditions posées par le juge
- Enquêtes de mesure de la diversité au travail : les recommandations de la CNIL
- Violation de la clause de non-concurrence et remboursement de la contrepartie financière : une règle qui s’applique si la clause n’est pas valable
- Transposition de la directive : la transparence des rémunérations dès l’embauche
- Canicule : Nouvelles obligations relatives à la prévention des risques liés à la chaleur au travail


